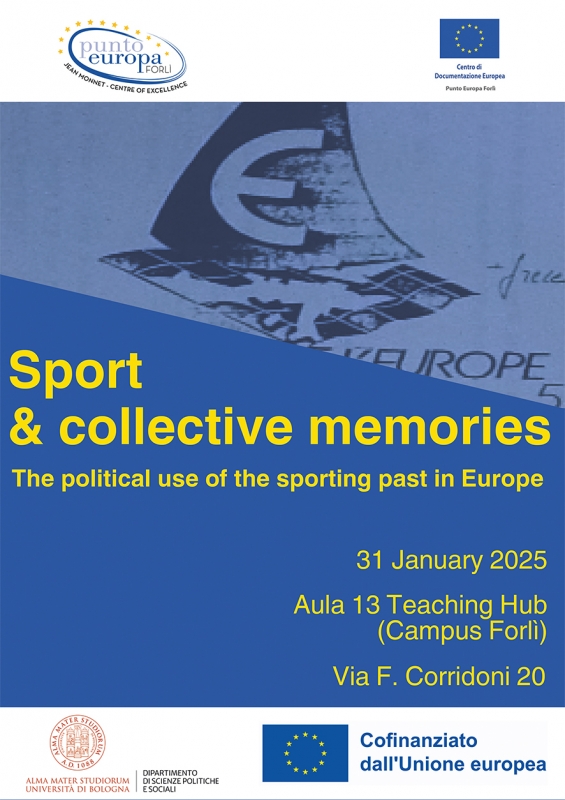Brésil
En octobre 2024, j’ai effectué une mission de travail en Allemagne pendant quinze jours. Ce séjour m’a permis de mener à bien des recherches complémentaires sur l’un de mes domaines de compétence, le football, notamment la représentation de l’histoire du ballon rond à travers les musées du sport et leurs expositions. Parmi les thèmes qui me sont chers, je citerais la mondialisation et la migration des joueurs de football contemporains, le débat sur les transformations induites par la construction d’enceintes sportives polyvalentes sur les formes et les styles de supportérisme, ou encore l’élargissement de la notion de « football », avec le dépassement de l’image traditionnelle et dominante du football professionnel masculin et son intégration dans les pratiques variées des groupes sociaux qui, dans différents contextes et à différentes échelles, composent l’univers du football avec la même légitimité et la même importance.
J’ai donc passé les mardi 8 et jeudi 10 octobre 2024 à visiter le Deutsches Fußball Museum1 de Dortmund et à rencontrer deux de ses conservateurs. Mon idée était d’abord de connaître le musée afin de recueillir des informations et des éléments avant d’échanger avec ses responsables. Depuis 2010, date à laquelle j’ai rejoint l’École des sciences sociales de la Fondation Getulio Vargas (FGV CPDOC), mon programme de recherche comprend des collaborations avec le Musée du football de São Paulo et d’autres musées du même type, y compris des recherches sur les collections sonores du Musée de l’image et du son (MIS). En ce qui concerne plus particulièrement le Musée du football de São Paulo, j’ai développé un partenariat pour le projet de recherche « Football, mémoire et patrimoine », dont l’objectif est de créer une base de données des anciens joueurs de l’équipe nationale brésilienne qui ont participé aux Coupes du monde entre les années 1950 et 1980. Ce projet justifiait mon intérêt pour une visite technique au Musée national du football à Dortmund. La proximité avec les responsables de l’équipement et les techniciens du Centre de référence du football brésilien/CRFB – un espace de recherche du musée brésilien depuis 2013 – a contribué à éveiller mon intérêt pour les biens culturels et la muséologie. D’autres visites ont été effectuées dans une série de musées à l’étranger consacrés au sport. Je peux citer Glasgow, Manchester, Linzi (Chine), Lausanne et Zurich, entre autres, qui disposent de musées consacrés à l’Olympisme ou au football. Les séminaires et autres activités académiques auxquels j’ai pu participer m’ont permis de visiter le FIFA Museum (Zurich) et celui du Comité international olympique à Lausanne. En Grande-Bretagne, j’ai pu me rendre au National Football Museum de Manchester et à ses alter ego d’Écosse et d’Irlande du Nord (Belfast). Sans oublier les nouveaux musées de club qui ont vu le jour un peu partout dans le monde à la fin du xxe siècle ou au cours de ce premier millénaire, comme ceux de Boca Juniors et de Barcelone, de Chelsea et de Porto, de Liverpool et de Flamengo, pour n’en citer que quelques-uns que je connais.
Il m’a donc semblé opportun de me rendre au Musée du football de Dortmund, mais aussi de dialoguer avec son équipe de conservation et de médiation pendant mon séjour dans la ville. Mardi 8 octobre, j’ai pris connaissance de l’exposition et du complexe muséal. J’ai retiré de cette visite un certain nombre d’impressions qui rappellent ces autres musées bien connus, en particulier le musée brésilien. Je me réfère à des perceptions comparatives du parcours de l’exposition, en identifiant des similitudes et des différences narratives qui ne peuvent pas être développées de manière exhaustive ici, mais seulement brièvement rapportées.
Figure n° 1. Vue de l’entrée du Musée du football de Dortmund.
Crédit : Bernardo Buarque.
La première chose qui retient l’attention est la monumentalité du bâtiment lui-même, frappante pour toute personne passant à proximité, dans un espace central de la ville de Dortmund. L’architecture, l’éclairage et les installations vidéo captent l’attention du visiteur dès l’extérieur du musée. Son abord est accueillant avec une place aménagée comme une extension de l’espace public du musée, comprenant un terrain de football pour les enfants, la reproduction d’un ballon géant et des plaques faisant allusion à l’équipe nationale allemande et à ses performances. Le hall d’entrée mêlent ces références, images et couleurs, avec un café et une boutique, qui créent ainsi une première ambiance de ce lieu immersif, par la grâce aussi de la société de consommation, peut-on aussi relever.
Ces premières remarques sont à mettre en relation avec mes échanges avec Carina Bammesberger, la conservatrice qui m’a accueilli, le jeudi 10 octobre. Elle a en effet fait une remarque sur la relation entre l’architecture extérieure et les espaces muséaux. Contrairement à la plupart des musées en général, et pas seulement ceux qui ont trait au football, à Dortmund, c’est la conception de l’exposition permanente qui a inspiré la configuration architecturale du bâtiment, et non l’inverse, comme c’est habituellement le cas. En amont de la réunion de jeudi, j’avais relevé que le musée datait de 2015 et que, pour 2025, ses responsables préparaient des mises à jour après une première décennie d’existence. Le musée est en partie une conséquence (ou un héritage) de la Coupe du monde 2006. Le DFB (Deutscher Fussball Bund2), l’un de ses principaux promoteurs et sponsors, a choisi Dortmund en raison de la popularité du football dans cette ville de la Ruhr. Le siège de la fédération allemande est lui installé à Francfort, où l’organisation conserve ses archives sur le football. Il s’agit ainsi de découpler la recherche dans les archives de la visite et de la vie du musée. Ce qui rapproche l’institution de Dortmund du National Football Museum de Manchester, en Angleterre, dont les fonds d’archives sont conservés dans la ville de Preston, mais l’éloigne du musée Museu do Futebo de São Paulo, dont le centre est situé à l’intérieur de l’espace muséal.
Revenons à notre visite du mardi. Une fois le billet acheté à l’accueil, le parcours de la promenade simule un vaste escalier et une trajectoire ascendante. Dans une sorte de tunnel temporel, on passe du niveau inférieur au niveau supérieur. L’ascension se fait par un long escalator, inséré entre deux murs dont les parois sont peintes et décorées de supporters portant les maillots et couleurs de diverses équipes allemandes et de la Mannschaft. Ce qui crée une première atmosphère colorée, sonore et immersive dans la culture football, comme si l’on sortait des vestiaires et que l’on s’apprêtait à entrer dans un stade.
Figure n°2. Escalator menant au premier étage. Les murs sont décorés de dessins de supporters portant les maillots des clubs allemands et de l’équipe nationale.
Crédit : Bernardo Buarque.
Le deuxième jour, lors de la visite guidée, il m’a été précisé que le mur décoré reproduisait la géographie des clubs et de leurs supporters dans le sens du sud de l’Allemagne vers le nord, de l’est vers l’ouest, ce que je n’avais pas remarqué ou compris lors de ma première visite. Après ce passage tubulaire, on accède au premier étage, le plus élevé, où commence le parcours horizontal puis descendant. Les salles sont vastes en hauteur comme en longueur, ce qui est typique des musées en général. L’effet est d’emblée hyper-sensoriel, avec des alternances chromatiques de clair et d’obscur, mais aussi avec la mobilisation du gris et le jeu des couleurs tricolores du drapeau national – noir, rouge et or – mais pas seulement. L’espace grandiose est divisé en macro, méso et micro espaces, dans une sorte de labyrinthe de données, de miroirs et de récits parmi lesquels chaque visiteur peut picorer selon des goûts. Corridors, totems, vitraux, cabines et maquettes se succèdent tout au long du parcours, un grand nombre d’entre eux consistant dans des dispositifs technologiques et interactifs qui attirent l’attention.
On pourrait dire que le côté futuriste de l’ensemble coexiste avec une certaine nostalgie du passé, invoqué par la reconstitution d’objets liés à des matchs mémorables, tels que le maillot original, le ballon de cuir, la chaussure de cuir épais, le billet du dernier match de la Coupe du monde de 1954, entre autres artefacts qui suggèrent l’authenticité et l’aura de ce qui était autrefois et de ce qui n’existe plus. La scénographie couvre les thèmes canoniques des musées de ce type, à savoir, les Coupes du monde et leurs conquêtes par l’équipe nationale ; l’histoire du football et sa chronologie ; la participation des femmes et leur lutte pour la visibilité ; les principales idoles et leurs exploits, les performances des athlètes et leur hall of fame à la manière des stars du cinéma ; la couverture médiatique – presse, radio et télévision – et son évolution technologique au cours du xxe siècle ; l’imaginaire du supporter, acteur secondaire qui devient protagoniste du fait de sa présence dans les stades et de son rôle dans la fascination pour le football.
Le parcours commence au dernier étage, avec le « miracle de Berne » (conquête de la première Coupe du monde en 1954) et descend progressivement, en passant par un long couloir de pièces centrales et adjacentes qui délimitent différents thèmes et leurs temporalités. Le caractère sphérique du ballon sert également de support à des analogies plastiques avec la planète Terre et sert la métaphore et l’imaginaire du rond (pour évoquer la philosophie de Gaston Bachelard). La Coupe du monde permet d’intégrer dans le parcours les nations du monde entier qui s’y affrontent. La transition vers l’étage inférieur se fait par une salle de cinéma 3D, dans laquelle une vidéo de 12 minutes crée une animation humoristique avec des footballeurs allemands de plusieurs générations, de l’entraîneur de la Coupe du monde de 1954 aux idoles de la dernière conquête en 2014.
Figure n° 3. Vue du premier étage du musée, dont le large et long couloir est divisé entre secteurs thématiques et chronologiques, autour de formes sphériques et circulaires faisant l’analogie entre la planète Terre et le football, via la référence au ballon.
Crédit : Bernardo Buarque.
Les salles du rez-de-chaussée recèlent encore une quantité importante d’informations, de statistiques et de vitrines remplies d’artefacts. Leurs attraits visuels, sonores et techniques sont renforcés par l’architecture imposante combinée à la multiplicité des stimuli et à une infinité de ressources interactives et sensorielles. Il est intéressant de noter, comme je l’ai fait remarquer le jeudi 10 octobre à la conservatrice Carina, qu’un visiteur qui s’arrêterait pour apprécier toutes les pièces exposées, lire leurs les cartels un à un et regarder toutes les vitrines, ne pourrait pas voir tout ce qui est exposé dans le musée en un seul jour.
Cette observation est renforcée par le fait que les deux étages sont rejoints par un troisième, au sous-sol, pour les expositions temporaires. Ce grand espace, avec son ouverture latitudinale et longitudinale, baigne dans une ambiance nocturne qui évoque, selon ma première impression, une grotte scénique. Le contrepoint est presque immédiat, ou évident, avec la dimension circulaire et ensoleillée des étages visités au-dessus. L’exposition consistait en une installation géante sur l’art et le football, avec un espace immersif pour une vidéo expérimentale de 40 minutes, soit une superposition d’images artistiques du plus haut niveau et du plus grand sens esthétique, dans la construction d’une expérience dense et stimulante.
À mon avis, sans doute parce que je travaille sur l’interface football/art dans mes recherches, cette salle a été le point culminant de ma visite au musée. C’est la salle la plus originale et la plus audacieuse de tout l’espace muséal, qui échappe aux pièges et aux conventions inévitables qu’implique la représentation du football dans une exposition. Elle remet également en question les attentes que suscite un musée consacré au football en fonction du profil du public, qu’il s’agisse de ceux qui sont uniquement attachés émotionnellement au sport ou des visiteurs du musée qui apprécient d’abord le concept artistique quel que soit le lieu où ils se trouvent.
Figure n° 4. Espace du premier étage consacré à l’équipe nationale allemande et à ses performances.
Crédit : Bernardo Buarque.
Jeudi 10 octobre, j’ai donc rencontré Carina Bammesberger qui appartient à l’équipe des conservateurs du musée. Diplômée en archéologie à l’université de Cologne, elle travaille au Musée national allemand du football depuis 2020. Une autre conservatrice, Janine Horstmann, devait également être présente, mais n’a pu venir. Un membre de l’équipe éducative, appelé Hake, nous a accompagnés lors de la nouvelle visite, cette fois guidée, avec une pléthore d’informations qui a permis de compléter celle que j’avais réunies le premier jour, lorsque je m’étais promené seul dans l’espace. La conversation et la visite ont duré près de trois heures, avec des échanges d’informations avec les conservateurs allemands et une réflexion comparative avec le musée du Brésil et ceux d’autres pays que j’ai pu visiter. Le contact a également permis de discuter d’éventuels échanges et autres rencontres académiques, en vue d’événements importants du calendrier sportif, comme la Coupe du monde féminine de la FIFA, qui se déroulera au Brésil en 2027. Enfin, lors de la visite de jeudi, j’ai remarqué qu’il y avait plusieurs supporters du club écossais du Celtic Glasgow dans le musée. Ce qui n’était pas tout à fait fortuit. En effet, depuis lundi, ils étaient en ville, facilement identifiables à leurs vives couleurs vertes, dans l’attente du match de Ligue des Champions opposant le lendemain leur club au Borussia Dortmund. Toutefois, l’ambiance m’a semblé bon enfant et aucun incident n’a été signalé, peut-être en raison de l’absence de rivalité ou contentieux historique opposant les deux formations. Ledit match a eu lieu le mercredi 9 octobre. J’ai appris le lendemain que l’équipe écossaise avait été battue 7-1... En tant que Brésilien qui étudie le football et qui se trouve en Allemagne, il est impossible d’échapper au mécanisme associatif et mémoriel du tableau d’affichage et j’ai pensé qu’il valait mieux m’arrêter là…
Compte tenu de ce que je viens d’évoquer, je termine ici ces lignes peut-être un peu impressionnistes en remerciant chaleureusement mon superviseur Christian Brandt (université de Bayreuth), qui m’a fait découvrir non seulement ce magnifique musée, mais également son pays d’origine, ce que je n’aurais pu faire par moi-même aussi bien.
Bernardo Buarque
Italie
Le 31 janvier 2025, s’est tenue sur le campus de Forlì de l’université de Bologne une journée d’étude intitulée « Sport & Collective Memories. The Political Use of the Sporting Past in Europe ». Cet événement s’inscrivait dans le cadre du projet « Sport and International Politics in Europe » soutenu par le programme Erasmus +, qui a notamment financé un enseignement triennal sur cette thématique au sein du département de sciences politiques et sociales de l’université de Bologne.
Bien qu’elles ne soient pas exclusivement consacrées aux études sur le football, la plupart des présentations avaient, au moins en partie, trait au ballon rond. L’une d’entre elles a été présentée par Paul Dietschy, professeur à l’université Marie et Louis Pasteur de Besançon et directeur de la revue Football(s). Histoire, culture, économie, société. Son intervention consacrée à la mémoire des stades en Europe, a non seulement envisagé les stades en tant qu’élément du patrimoine culturel des villes qui les accueillent, mais a également insisté sur la manière dont l’avènement d’Internet et des blogs, d’abord, puis du Web 2.0 et des réseaux sociaux, a contribué à l’explosion d’une mémoire du football fondée davantage sur le désir de construire des récits légendaires que sur celui de reconstituer le passé sportif de la manière la plus rigoureuse qui soit. L’intervention de Juan Antonio Simon, de l’Universidad Politécnica de Madrid, a également porté sur la mémoire des stades, mais en se concentrant uniquement sur le cas espagnol notamment barcelonais et madrilène.
Figure n° 5. Locandina (affichette) de la journée d’étude du 31 janvier 2025 à l’université de Bologne (campus de Forlì).
Crédit : Université de Bologne.
André Gounot (université de Strasbourg) a proposé une comparaison entre les mémoires du « Cerro Pelado » à Cuba et du « Miracle de Berne » de 1954 en Allemagne. L’intervention de Daniele Serapiglia, de l’université Complutense de Madrid, est revenue sur la construction de la mémoire de la tragédie de Superga et du Grande Torino. Non plus en Italie mais au Portugal (où les granata avaient joué leur dernier match avant le tragique accident) et en Espagne (d’où, après une escale, l’avion était parti pour la capitale piémontaise). Enrico Landoni, de l’université eCampus, a présenté une intervention sur la manière dont le tragique accident de voiture au cours duquel l’ancien libéro de la Juventus et de l’équipe nationale italienne Gaetano Scirea a perdu la vie en septembre 1989 a été commémoré non seulement en Italie, mais aussi en Pologne, le pays où l’accident s’est produit. Giovanna Russo (université de Bologne) a consacré son temps de parole à des réflexions sociologiques sur la culture matérielle produite par les supporters d’un club (en l’occurrence le Bologna Football Club). Ces derniers, construisent, au fil du temps, un patrimoine qui, d’une part, s’inscrit dans la mémoire individuelle et familiale des supporters et, d’autre part, contribuent à forger une mémoire collective de la communauté imaginée des supporters rossoblù qui peut, à son tour, être réutilisée à des fins de marketing par le club lui-même. Plus strictement politique, la réflexion de Lorenzo Venuti (université de Bologne) a analysé la façon dont le parti de Viktor Orbán promeut chez lui un récit pro domo du mythe de l’Aranycsapat (le onze d’or), c’est-à-dire l’équipe nationale hongroise qui a dominé le football mondial au milieu des années 1950 bien qu’elle n’ait jamais réussi à remporter une Coupe du monde. Enfin, Erminio Fonzo (université de Salerne), en abordant la question de l’instrumentalisation de l’activité ludique de la Rome antique par le régime fasciste pour légitimer et glorifier les sports promus pendant les vingt années du fascisme, a rappelé, entre autres, les efforts produits par les intellectuels en chemise noire pour construire le mythe des origines italiennes du football par des liens forcés avec les pratiques de l’harpastum romain et du calcio fiorentino.
Malheureusement, l’intervention de Francesca Tacchi consacrée à la mémoire des premières Coupes du monde non officielles de football féminin disputées en 1970 en Italie et en 1971 au Mexique a dû être annulée. Toutefois, les contributions de cette intéressante journée d’étude seront publiés en anglais dans la revue Storia dello Sport. Rivista di Studi Contemporanei.
Nicola Sbetti