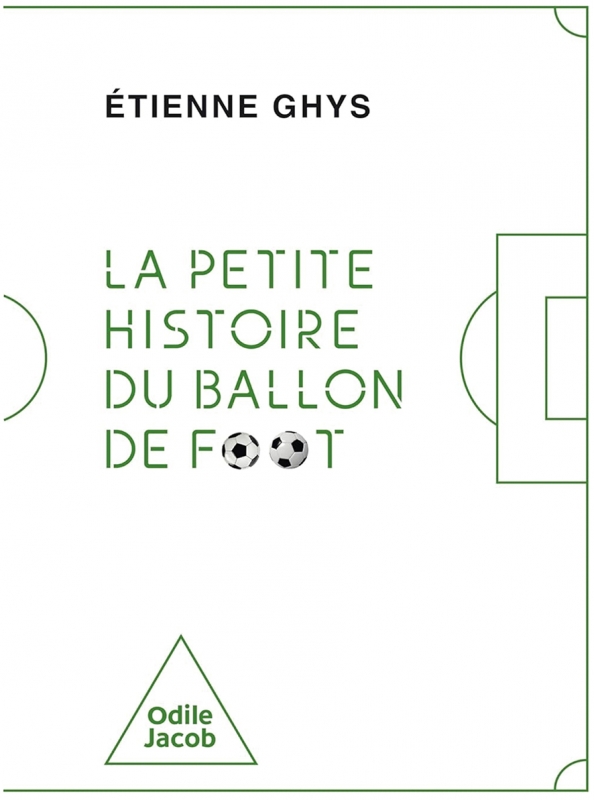Le titre du petit livre du mathématicien Étienne Ghys, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, suscite autant la curiosité qu’il mérite d’être expliqué. Il n’est pas question ici d’histoire culturelle, économique ou sociale du ballon de football. Le propos de l’auteur est de penser la forme et les mouvements de cet objet en spécialiste de mathématiques et sciences physiques. Son livre rend ainsi compte de l’attention portée depuis au moins deux décennies au sport par les spécialistes de ces disciplines comme Christophe Clanet à l’École polytechnique. Leurs colloques évoquent aussi la trajectoire des ballons qu’Étienne Ghys étudie dans un petit livre enlevé et illustré.
Première question investiguée par l’auteur : la rotondité de la sphère utilisée pour jouer au football. Il est évident pour tout le monde que le ballon est rond. Certes, mais le cuir longtemps utilisé pour sa fabrication est une matière rigide et modulable dont les propriétés ne permettent pas d’atteindre une forme complètement ronde avec un seul morceau. Un ballon est donc un assemblage de polygones de différentes tailles. Lesdits polygones sont assemblés pour réaliser une sphère. D’un point de vue scientifique, la première méthode réside dans l’utilisation de solides de Platon (polygones dont le nombre de côtés et angles sont égaux). Avec tout de même un petit souci : les limites entre les polygones sont marquées par des angles. Essayez donc de tirer un but avec un ballon anguleux qui, de surcroît, peut blesser le gardien de but ! Aussi, pour réaliser le Telstar, le ballon star d’Adidas utilisé pour la première fois en Coupe du monde au Mexique en 1970, on a choisi un icosaèdre, le solide de Platon le plus rond qui soit, et dont les angles ont été tronqués. En tant que polygone tronqué, le Telstar a eu des héritiers chez Adidas. Jabulani, le ballon de la Coupe du monde sudafricaine (2010) était ainsi un tétraèdre tronqué. Les ingénieurs qui l’ont conçu à partir de huit pièces arrondies (ce qui ne facilite pas sa production) ont aussi inventé un ballon à la trajectoire aléatoire. La question de la pénétration dans l’air était déjà à l’ordre du jour quatre ans plus tôt avec Teamgeist (toujours Adidas), composé de huit pièces hexagonales et 6 pièces dites « carrées » car à 4 côtés allongés. Les pièces s’imbriquaient de telle sorte que le montage nécessitait moins de coutures. Cette réduction a pour effet que Teamgeist glisse mieux dans l’air. Al Rihla, le ballon de la dernière Coupe du monde (2022) consiste lui en un ajustement de « cerf-volant » et de triangles. La nouveauté technologique a surtout résidé dans la connexion avec des capteurs qui permettent de retransmettre les mouvements du ballon et d’avertir l’arbitre de sa position.
Étienne Ghys passe ensuite à l’analyse de la trajectoire des ballons, une question suscitant souvent débats et polémiques au sein du Landerneau du football. Premier élément du dossier : la matière utilisée pour assembler un ballon. Telstar était fabriqué en cuir, une matière lisse mais avec des irrégularités pouvant freiner le ballon dans l’air. De fait, qu’il soit lisse ou rugueux, le ballon se comporte différemment. Ainsi Teamgeist, le ballon le plus lisse jamais réalisé en synthétique et comportant un nombre minimal de coutures, « permet des centres parfaits ». Jabulani, et ses huit panneaux collés thermiquement, a fait l’unanimité contre lui. Il était considéré comme « un vulgaire ballon de supermarché », en raison de la micro-texture de ses panneaux, qui rendait sa trajectoire imprévisible et impopulaire auprès des joueurs.
Pour comprendre le lien entre la matière des ballons et leur trajectoire, Étienne Ghys invite à consulter les études de balistique car la trajectoire d’un ballon ressemble à celle d’un boulet de canon ! De fait, un ballon en vol est soumis à différentes forces : la gravité et les forces de réaction de l’air. Imaginons que ces forces n’existent pas : le ballon serait alors lancé avec une force constante en ligne droite ; or celles et ceux qui ont joué au football n’ont jamais vu un ballon partir droit vers l’espace, ce qui suggère par l’expérience du terrain que ces forces existent. Envisageons maintenant l’influence du poids sur une sphère en mouvement. La balle de pétanque lancée suivra une courbe parabolique en forme de U retourné. Le ballon, plus léger, subira les forces de frottement de l’air et la parabole qu’il décrit sera par conséquent beaucoup plus plate. À l’origine de ce phénomène se trouve la viscosité de l’air dont dérivent la portance et la traînée. La traînée, la force qui nous intéresse ici, se comporte de telle sorte qu’à faible vitesse, la viscosité domine. Toutefois, au football, les ballons en l’air vont rarement en dessous d’1 km/h. Si la vitesse est plus forte, la viscosité n’est plus le seul facteur influençant la traînée. Vers l’avant du ballon, une fine pellicule d’air se forme, comme une seconde peau, c’est ici que la viscosité domine et joue alors un rôle important sur le ballon. Sur la face externe de cette pellicule, l’air est trop loin du ballon, il ne colle plus à la sphère. C’est le même principe qui permet aux avions de voler. À l’arrière du ballon, l’air ne colle pas non plus à sa surface, il s’agit du sillage, une zone où la pression est basse, car le sillage « aspire » la boule, c’est l’une des origines de la traînée.
Comme Étienne Ghys le rappelle, jusqu’ici, nous étions encore en régime laminaire, c’est-à-dire un régime d’écoulement caractérisé par une diffusion de quantité de mouvement élevée et une convection faible. Augmentons encore la vitesse du ballon afin d’obtenir un régime turbulent. Sur la fine pellicule dont nous parlions à l’instant (seconde peau), l’air devient soudain turbulent et donne un mouvement irrégulier et erratique à la balle. Cette seconde peau adhère mieux à la balle, le sillage devient plus réduit et l’aspiration moins forte, donc la traînée diminue. Cette limite entre régimes laminaire et turbulent s’appelle la crise de la traînée. Elle dépend de la rugosité de la balle. Un ballon parfaitement lisse sera freiné par l’air. Il faut donc un matériau et un nombre de coutures uniformes sur toutes les faces. Ainsi, Telstar avec ses 4 mètres de couture avait une vitesse de crise plutôt homogène sur toutes les faces. Teamgeist qui a de grandes zones lisses, présente différents états de crise correspondant à différentes surfaces du ballon, ce qui rend sa trajectoire imprévisible… Jabulani est le plus lisse avec de grands sillons, et donc des états de crise encore plus imprévisibles avec des trajectoires erratiques. Pour prévenir celles-ci, les ingénieurs qui ont mené des expériences en soufflerie, ont donc pensé à placer sur les surfaces de nouveaux ballons comme Al Rihla de petites pointes que l’on trouve aussi sur les balles de golf. Ce dispositif permet d’arriver à une vitesse de crise homogène sur l’ensemble du ballon.
En suivant l’auteur de la Petite histoire du ballon de foot, expliquons maintenant l’effet de spin (effet donné au ballon). Pour ce faire, il est nécessaire de revenir à l’effet Venturi. Celui-ci explique la variation de la vitesse de l’air à débit constant lorsque la section par laquelle l’air qui passe rétrécit. Imaginons un ballon qui vole en tournant sur lui-même. Sur sa partie supérieure, la rotation du ballon s’ajoute à la vitesse du vent. La pression est donc inférieure sur cette partie. Il en résulte une force de portance sur le haut du ballon. En termes footballistiques, le joueur devra « brosser » le ballon afin de lui donner cet effet de rotation. Si l’axe est horizontal, en théorie, la force de portance va tirer le ballon vers le haut ce qui lui donnera une trajectoire de spirale, effet qui n’est pas donné à n’importe quel footballeur de réaliser. Si l’axe est vertical, la trajectoire peut dévier de son plan initial. Ainsi, le 3 juin 1997 lors du match France-Brésil disputé à Lyon, Roberto Carlos tire un coup franc à la 22e minute qui a stupéfait les téléspectateurs du monde entier ! Le ballon a contourné le mur des joueurs français avant de pénétrer dans les cages gardées par Fabien Barthez. C’est la conséquence de la rotation du ballon résultant de la force de portance qui permet d’arrondir la trajectoire du ballon.
Pour finir, Étienne Ghys expose dans le dernier chapitre certains théorèmes de géométrie agrémentés d’exemples footballistiques. Si la lecture de ce petit livre nécessite une certaine culture scientifique, il se lit allègrement car l’on perçoit au travers de l’humour de l’auteur qu’il a su réunir ici deux de ses deux passions : la science et le football. Cet ouvrage est donc accessible pour les joueurs et joueuses qui veulent comprendre comment se forme la trajectoire qu’il donne à leur ballon et… qui disposent de quelques bases en mathématiques et en logique.