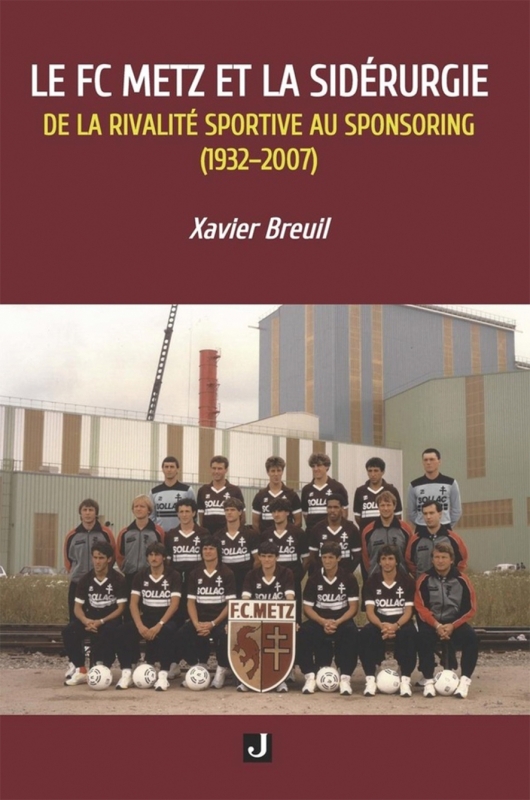Ce livre est indéniablement celui d’un historien1 reconnu par ses pairs, notamment par les chercheurs en sciences sociales qui travaillent sur le football. Auteur de plusieurs ouvrages qui traitent de l’histoire du ballon rond sous différents prismes tels que le football corporatif, le football féminin ou les paris sportifs, les derniers travaux publiés de Xavier Breuil étaient consacrés à un autre domaine : la société Les Laminoirs à froid de Thionville, spécialisée dans les pièces pour cycles (2023). Dans la continuité de cette thématique, le présent ouvrage assure donc la liaison entre la sidérurgie et le club emblématique de la Lorraine, le FC Metz. Pour ce faire, Xavier Breuil a manifesté à nouveau son « goût de l’archive » pour reprendre l’expression d’Arlette Farge, via, en particulier, des fonds industriels et sidérurgiques comme ceux d’Arcelor Mittal, mais également d’autres moins connus mais pas moins intéressants. Sciemment ou non, Xavier Breuil mobilise sa fine connaissance de l’histoire du club grenat, jusqu’à la touchante dédicace à son fils. On subodore qu’il en est un supporter à la fois passionné et lucide.
Trois chapitres divisent l’ouvrage. Le premier, aux bornes temporelles les plus étendues, décrypte des relations ambiguës que le FC Metz entretient avec le monde de la sidérurgie jusqu’en 1984. Le second décortique les processus de collaboration entre le club grenat et la Sollac, autrement dit la Société lorraine de laminage continu, une filiale du groupe sidérurgique Sacilor. Le dernier détaille les caractéristiques de ce parrainage innovant avec la Sollac puis Usinor (à partir de 1997), renouvelé contrat après contrat jusqu’à ce qu’il prenne fin en 2007.
Si des clubs messins existent et participent au championnat régional dès 1919, c’est l’instauration du professionnalisme en 1932 qui engendre la création du FC Metz et le projette sous les feux de la renommée régionale. Jusqu’alors d’autres sociétés de football avaient connu des fortunes plutôt glorieuses, comme à Hayange où les clubs s’inscrivent dans les visées du paternalisme sportif de la famille De Wendel. Le paternalisme du ballon rond est aussi à l’œuvre à Moyeuvre-Grande ou dans le bassin de Longwy. Mais, à partir de 1932, les clubs des bassins sidérurgiques commencent à souffrir de la concurrence du FC Metz, dont le statut professionnel est conforté par l’arrivée à la présidence de Raymond Herlory en 1934. Concomitamment, la popularité du club professionnel messin s’affirme : « le FC Metz devint le représentant de la Lorraine, de ses valeurs, de sa culture et de son histoire » (p. 44). La qualité du jeu proposé dans l’élite du football français, l’assurance de pouvoir admirer les équipes françaises les plus renommées, draine un public nombreux, y compris en provenance des bassins sidérurgiques du Pays-Haut et des vallées de la Fensch et de l’Orne, voire des Terres Rouges du Luxembourg. Le stade Saint-Symphorien, qui a été acquis par la municipalité messine pour le mettre à la disposition du FC Metz en 1935, affiche régulièrement de très belles affluences. En sus du public qui déserte leurs tribunes, les clubs des bassins sidérurgiques subissent d’autres affres, ceux de la concurrence du club grenat. Leurs joueurs les plus doués veulent bénéficier d’une forme d’ascension sociale en rejoignant les rangs du professionnalisme. Pour contrer une perte de vitalité et un appauvrissement avéré, certains clubs comme la Sportive Thionvilloise organisent des matchs amicaux avec des équipes professionnelles françaises, sans toutefois rencontrer un succès suffisant. Le club thionvillois, tout comme son homologue l’ES Hayange, envisage le passage au professionnalisme au mitan des années 1930, sans que ce projet n’aboutisse. C’est l’USB Longwy qui franchit le pas en évoluant au niveau professionnel, cependant au sein des divisions inférieures, ce qui ne permet pas au club de s’assurer des affluences suffisantes lors des rencontres officielles et conduit de facto à l’abandon du statut professionnel en 1945. En réalité, si des firmes sidérurgiques soutiennent à différents degrés les clubs locaux, aucun d’entre eux n’est en mesure de s’opposer à la popularité du FC Metz. Paradoxalement, le club grenat n’entretient aucune relation avec une firme sidérurgique avant 1984. En bref, ce chapitre ravira en particulier les amateurs d’histoire sportive locale, dans la mesure où Xavier Breuil met en perspective la renommée du club phare de la région avec celle d’autres clubs locaux, en décortiquant avec la patience d’un entomologiste les rouages économiques et sociaux qui président à leur destinée comme le paternalisme, l’espoir, d’ascension sociale, la popularité…
1984 est une année charnière à la fois pour le FC Metz et la sidérurgie lorraine, à tel point que les deux entités se retrouvent dans ce que l’auteur nomme « une communauté de destin » (p. 73). La sidérurgie lorraine se heurte à la fin des Trente Glorieuses à la chute de la croissance et à la concurrence internationale qui ont pour effet la suppression envisagée de 8 500 emplois dans le cadre du plan Acier ordonné par Laurent Fabius. Côté football, le destin du club messin contraste avec la situation des sidérurgistes, dans la mesure où le FC Metz remporte la Coupe de France pour la première fois de son histoire le 11 mai 1984. Dans l’intervalle et avec la bénédiction du président Carlo Molinari, le club fait cause commune avec les salariés d’Usinor et de Sacilor, qui sont les entreprises menacées. Les sidérurgistes bénéficient du cadre des matchs officiels, parfois retransmis à la télévision, pour déployer leurs banderoles revendicatives ou manifester sur la pelouse du stade Saint-Symphorien durant la mi-temps. La finale de la Coupe de France leur offre par ailleurs une tribune de choix relayée par les médias nationaux. D’une part, leur club favori, par le biais de sa victoire en Coupe de France, se présente en magnifique métaphore de la capacité de résilience des Lorrains. C’est dans ce cadre qu’est signé un contrat de sponsoring entre le club et la Sollac, qui devient « la première firme nationalisée, tous secteurs d’activité confondus, à devenir sponsor d’une équipe de ballon rond » (p. 99), le 28 juin 1984. Les maillots et équipements des joueurs, les panneaux d’affichage, les calendriers et encarts publicitaires dans les journaux servent de support publicitaire à la Sollac, contre le versement d’1,5 million de francs par saison au club. D’autre part, des places gratuites et des abonnements annuels sont attribués à la firme pour ses salariés. Cependant cette signature ne se déroule pas sans oppositions, comme celles du président du conseil économique et social ou encore de représentants syndicaux de la Sollac. Mais ces velléités sont contrées par des mesures qui bénéficient aux salariés et permettent conjointement au FC Metz d’augmenter son nombre d’abonnés de façon substantielle, jusqu’à devenir le troisième club français dans cette catégorie après l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux. De surcroît, ce contrat signé avec une entreprise lorraine permet au FC Metz de réaffirmer sa vocation régionale et de s’imposer comme le principal club lorrain, au détriment de l’AS Nancy-Lorraine. Ce qui permet à l’auteur de ciseler une jolie formule : « club des sidérurgistes avant 1984, le FC Metz était devenu un club sidérurgique […] » (p. 113). Le rôle fondamental joué par les acteurs est mis en lumière avec acuité dans ce chapitre : ceux du président Carlo Molinari au soutien des sidérurgistes, de Marc Loison secrétaire général du club et responsable du sponsoring et cheville ouvrière du partenariat avec la Sollac, de même que celui, crucial, du maire de Metz Jean-Marie Rausch dans le retour à la direction du club de Carlo Molinari après quelques années d’absence.
Dans le dernier chapitre, Xavier Breuil décortique les mutations de la Sollac, devenue une société nationale et qui intègre le groupe Arcelor en 2002, puis d’Arcelor-Mittal en 2006. Mais des ruptures jalonnent aussi l’histoire du FC Metz, au gré des succès en Coupe de France en 1988 et en Coupe de la Ligue en 1996, assortis de participations aux coupes d’Europe de football, ou de la deuxième place en championnat obtenue en 1998 ; mais également en raison d’échecs perceptibles à travers les descentes en Ligue 2 en 2002 et 2006. Durant cette période, la participation de la Sollac au sponsoring du FC Metz, si elle est loin d’être négligeable, reste modeste au regard des pratiques en vigueur dans certains clubs français. Ainsi, elle est évolutive, les deux partenaires s’accordant sur le versement de primes d’intéressement en fonction des résultats sportifs de l’équipe messine. La location de loges, destinée aux partenaires prestigieux et aux clients de marque, s’ajoute à l’achat de billets en nombre croissant au fil des années. Ce sont donc bien des opérations de relations publiques qui bénéficient à la Sollac mais aussi au FC Metz, dans la mesure où ces nouveaux clients invités sont susceptibles à leur tour de louer des loges ou de revenir aux matchs. En interne, la firme récompense également ses employés, y compris des délégués syndicaux, en octroyant des billets individuels ou des abonnements annuels pour les différents services. Un autre point intéressant réside dans le renversement des priorités regardant la maîtrise du calendrier des rencontres non officielles. En cas de non-qualification européenne du club, c’est Bernard Serin, vice-président de la Sollac, qui négocie des matchs amicaux avec des clubs situés dans des régions sidérurgiques susceptibles de fournir des partenaires commerciaux. Ainsi, une rencontre contre le VFB Stuttgart (1986) et des contacts avec les clubs de Vérone, de l’Olympiakos, du Panathinaïkos, de l’AEK Athènes et de la Real Sociedad sont pris à l’initiative du futur président du FC Metz (il le deviendra en 2009). Mais c’est à travers les échanges avec la firme sidérurgique sud-coréenne Posco que se matérialise l’interventionnisme de la Sollac. Ainsi, l’équipe d’entreprise professionnelle Posco Atoms affronte à plusieurs reprises le FC Metz en 1987 et 1988, toujours à l’initiative de Bernard Serin, qui profite de ces rencontres pour réunir des entreprises françaises partenaires de la Sollac et des dirigeants de Posco, dans le but de négocier des contrats commerciaux.
Le FC Metz devient aussi un débouché pour les produits sidérurgiques. Ainsi, une boîte de bière métallique aux couleurs du club et de la Sollac est produite à partir de 1986, afin que la société Amos commercialise la marque Mosbraü en exclusivité lors des matchs disputés à Saint-Symphorien. Cette boîte de bière, « la bière des supporters », est écoulée à plusieurs millions d’exemplaires sur plusieurs années. Mais c’est surtout la construction de la nouvelle tribune Nord du stade Saint-Symphorien en 1987 qui symbolise la traduction du savoir-faire industriel de la Sollac. L’entreprise remporte l’appel d’offres et réalise la prouesse de livrer une toiture en acier qui s’élève à 25 mètres de hauteur et surplombe des gradins en béton armé, en moins de six mois.
De son côté, le club messin réussit à diversifier ses partenariats en choisissant de s’adresser aussi au Conseil régional de Lorraine en 1989, puis au Conseil général de Moselle. De plus, il crée un « Club Entreprises », afin d’associer des PMI et PME à l’image du club et de bénéficier de ce fait de davantage de rentrées financières. Cette décision permet de compenser en partie la perte d’identité régionale de la Sollac, qui soutient dorénavant d’autres régions. Le partenariat s’essouffle à la suite d’une nouvelle relégation du club grenat en Ligue 2 à l’issue de la saison 2005-2006 et cesse définitivement en 2007. Ce dernier chapitre conserve la même acuité pour analyser les enjeux économiques, la création de réseaux à l’interface du sport et de l’industrie, les stratégies de communication déployées par les deux partenaires, la prise de pouvoir des capitaines d’industrie tels que Bernard Serin, y compris dans le domaine sportif. On ne résistera pas à la tentation, en guise de madeleine de Proust à destination des supporters inconditionnels, d’énumérer quelques joueurs messins issus des différents bassins sidérurgiques, qui ont contribué à renforcer l’identité sidérurgique du FC Metz : David Zitelli, Alain Colombo, Sylvain Kastendeuch, Carmelo Micciche, Michel Ettorre, Thierry Pauk, Philippe Hinschberger, Bernard Zénier pour la période des années 1980-1990 ; François Zdun dans les années 1970 ; René Grimbert, Roland Massucci et Rolland Ehrhardt dans les années 1960 ; Henri Nock, Claude Mastrangelo et Gustav Muller dans les années 1940 ; Charles Zehren, Charles Kappé, André Frey, Hippolyte Gusse, Louis Lisiero, Jean Lauer, Marcel Muller, Léon Esse, et Herbert Schuth dans les années 1930.
Cet ouvrage s’adresse donc évidemment aux chercheurs en histoire du football, mais également à ceux qui s’intéressent au monde du travail et de l’industrie, à l’économie et au marketing. Il procure une occasion de parcourir des sentiers qui n’ont pas encore été rebattus, à l’image des nombreux travaux consacrés à l’Olympique de Marseille, au Paris Saint-Germain, à l’AS Saint-Étienne, voire à l’Olympique Lyonnais… en mettant en lumière un club modeste mais immuable dans le paysage professionnel depuis 1932. Accessible à tous, parce que Xavier Breuil décode avec clarté et simplicité les mécanismes respectifs des deux mondes, celui de la sidérurgie comme celui du football pour mieux en faire émerger les relations, ce livre est aussi destiné à tous ceux qui ont le cœur grenat.